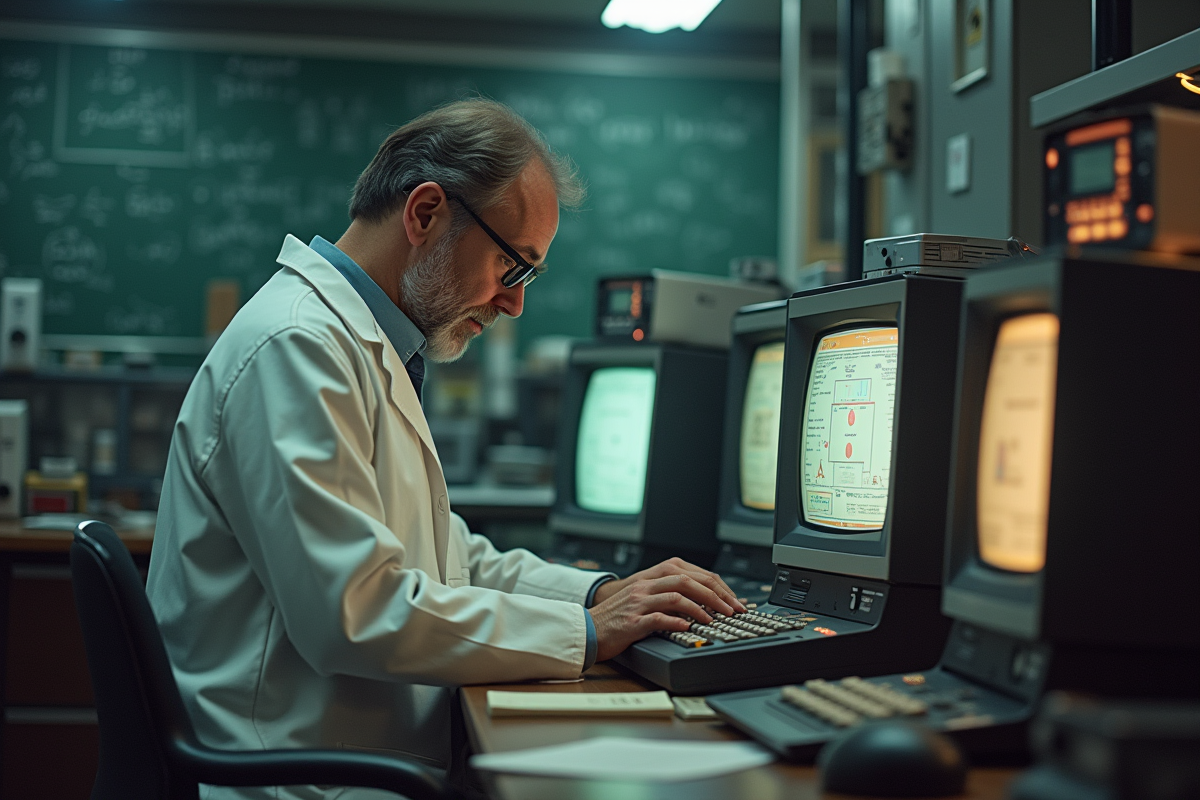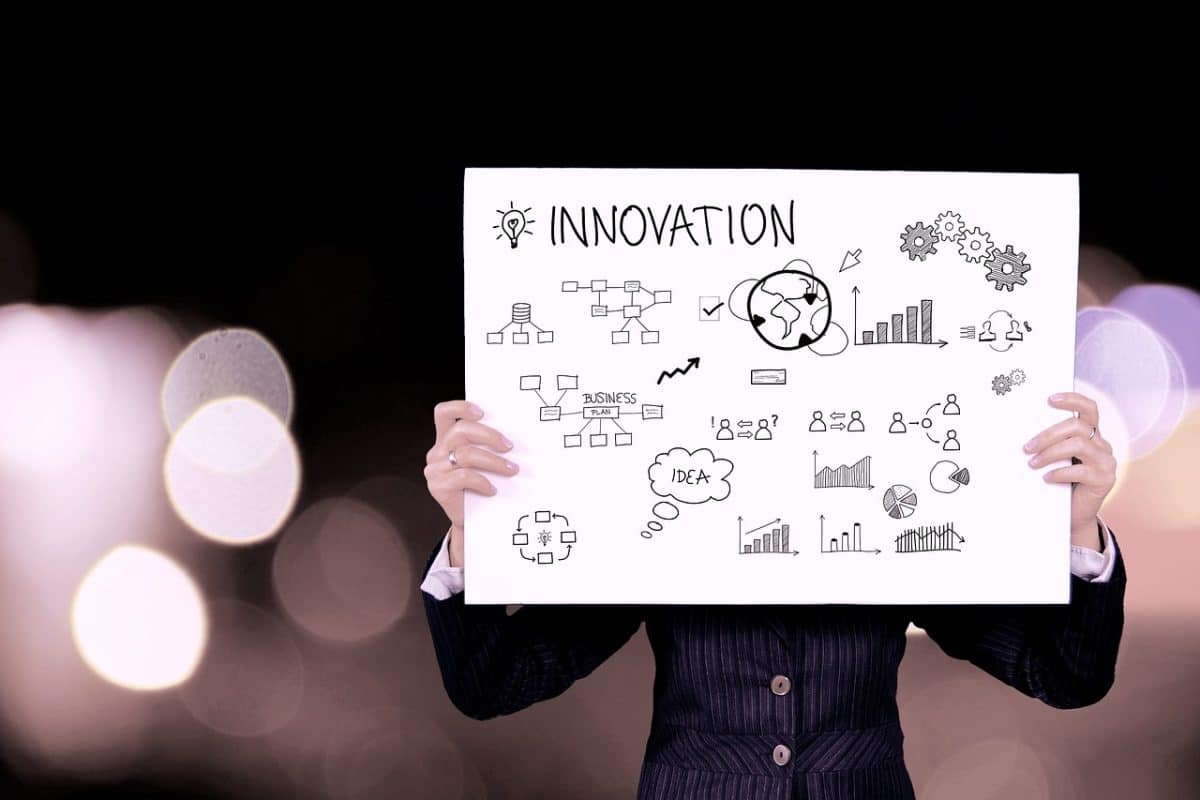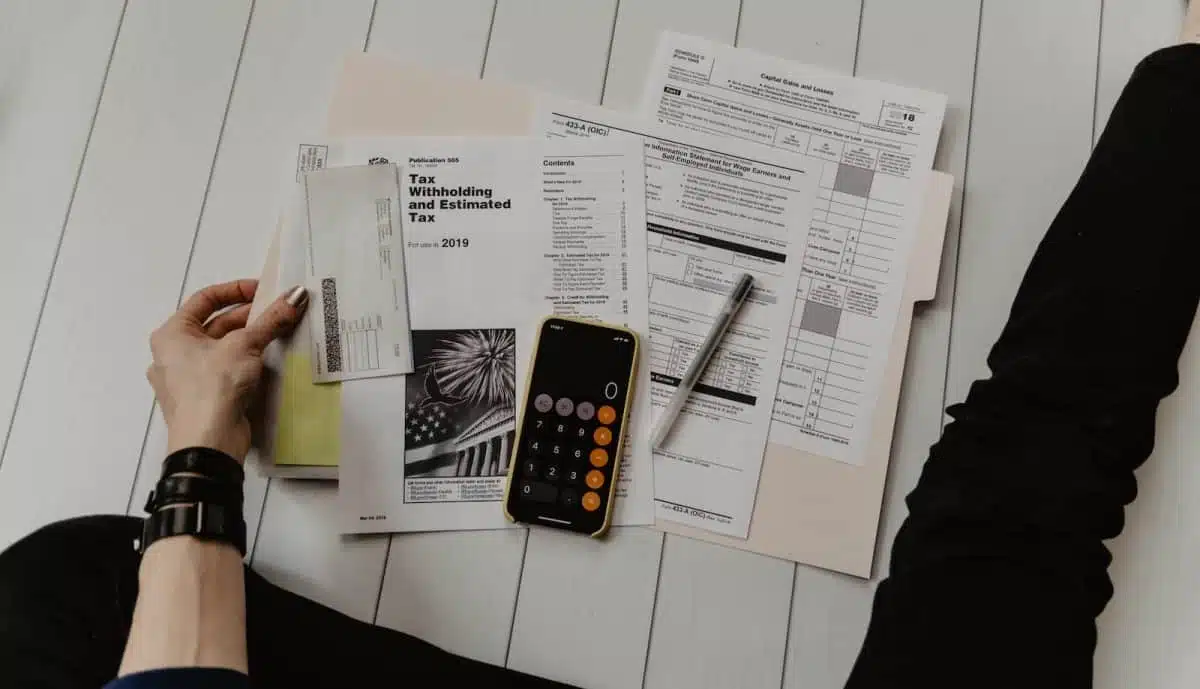En 1981, Richard Feynman expose l’impuissance des ordinateurs classiques face à certains calculs de la physique quantique. Cette année-là, il propose une nouvelle approche : utiliser la mécanique quantique elle-même pour réaliser des calculs jusque-là impossibles.
Contrairement aux machines électroniques traditionnelles, cette idée ne s’appuie pas sur la logique binaire. Le concept s’impose d’abord comme une solution technique à une limite fondamentale, avant de devenir un enjeu scientifique et industriel majeur.
Aux origines de l’informatique quantique : quand la physique rencontre l’informatique
Le XXe siècle n’a pas seulement bouleversé nos certitudes, il a ouvert une brèche. Quand Max Planck met au jour les quanta en 1900, il ne fait pas qu’éclairer la lumière : il redéfinit la façon d’appréhender l’énergie. Treize ans plus tard, Niels Bohr dresse un modèle d’atome qui donne enfin un visage à ce que l’œil ne perçoit pas. Ces percées font plus que marquer les esprits, elles redessinent les frontières de la matière, de l’information, de l’énergie. La physique quantique s’impose, avec ses paradoxes et ses possibilités inédites.
En 1925, Werner Heisenberg développe la mécanique matricielle. À peine un an plus tard, Erwin Schrödinger pose les bases de la mécanique ondulatoire. Deux visions, un même bouleversement : la dualité onde-particule, l’incertitude, la superposition. D’abord théoriques, ces idées vont devenir, bien plus tard, les fondations de l’informatique quantique.
| Année | Découverte | Scientifique |
|---|---|---|
| 1900 | Découverte des quanta | Max Planck |
| 1913 | Modèle d’atome quantique | Niels Bohr |
| 1925 | Mécanique matricielle | Werner Heisenberg |
| 1926 | Mécanique ondulatoire | Erwin Schrödinger |
La physique quantique ne demeure pas confinée aux expériences de laboratoire. Elle irrigue les technologies qui façonnent le présent. Voici quelques exemples frappants :
- Le transistor, véritable socle de tous les circuits intégrés modernes
- Le laser, à l’origine de révolutions dans l’industrie, la médecine, les télécommunications
- Le circuit intégré, qui a permis l’explosion de l’informatique numérique
Chacune de ces avancées s’appuie sur une maîtrise sans cesse affinée de l’infiniment petit. L’avènement de l’ordinateur quantique ne tombe pas du ciel : il s’inscrit dans une histoire où chaque découverte scientifique prépare la suivante. Les pionniers de la physique quantique n’imaginaient sans doute pas que leurs équations deviendraient, cent ans plus tard, le moteur de nouveaux calculateurs, mais leur héritage est bien là.
Qui a imaginé le premier ordinateur quantique ? Retour sur les pionniers et leurs idées fondatrices
L’émergence de l’ordinateur quantique n’est pas l’œuvre d’un seul esprit, mais le résultat d’un courant d’idées portées par plusieurs visionnaires. Au début des années 1980, Richard Feynman perçoit que les ordinateurs classiques ne peuvent pas simuler efficacement la mécanique quantique. Lors d’une conférence au MIT, il va droit au but : pourquoi ne pas bâtir une machine fondée sur les lois quantiques elles-mêmes ? L’idée s’incruste, avec la conviction que la nature résiste aux outils numériques traditionnels.
Dans les années 1990, la théorie devient concrète. En 1994, Peter Shor conçoit un algorithme pour factoriser de grands nombres, là où même les supercalculateurs s’épuisent. Deux ans plus tard, Lov Grover propose un algorithme qui accélère radicalement la recherche d’informations dans une base de données. Ces percées vont déclencher une course mondiale à l’expérimentation.
Les acteurs majeurs s’engagent. En 1998, IBM met au point un ordinateur quantique à 2 qubits, puis étend la prouesse à 7 qubits trois ans plus tard grâce à la résonance magnétique nucléaire. Google, de son côté, crée le processeur Sycamore doté de 54 qubits, réalisant en 2019 un calcul qui marque l’histoire de la discipline, en partenariat avec l’université de Californie à Santa Barbara. D’autres équipes se distinguent : la Chine avec Jiuzhang (calcul photonique), la France avec Pasqal (atomes neutres), ou des collaborations européennes comme celles de l’institut d’optique et l’université de Delft avec Intel.
Pour résumer les principales figures et innovations qui ont construit cette histoire :
- Richard Feynman : vision initiale et intuition décisive
- Peter Shor : algorithme de factorisation révolutionnaire
- Lov Grover : accélération spectaculaire de la recherche en base de données
- IBM, Google, Jiuzhang, Pasqal : réalisations et prototypes marquants
L’ordinateur quantique naît ainsi au croisement de la physique, des mathématiques et de l’ingénierie. Une idée d’abord théorique, devenue aujourd’hui un terrain d’expérimentation mondial.
Comment fonctionne un ordinateur quantique et en quoi diffère-t-il d’un ordinateur classique ?
Au centre de l’ordinateur quantique, on trouve le qubit. Là où le bit classique oscille entre 0 ou 1, le qubit, lui, peut être 0, 1 ou les deux à la fois grâce à la superposition propre à la physique quantique. Cette propriété démultiplie les possibilités : avec 50 qubits, on dépasse déjà ce qu’un supercalculateur classique peut envisager.
Autre différence clé : l’intrication quantique. Deux qubits intriqués deviennent inséparables, même éloignés de plusieurs kilomètres : l’état de l’un influence instantanément celui de l’autre. Cette particularité rend possible des calculs parallèles d’une ampleur inouïe, et ouvre la voie à des communications d’une sécurité inégalée.
Dans la pratique, les qubits prennent des formes variées : ions piégés, circuits supraconducteurs, atomes neutres, ou encore photons qui circulent dans des fibres optiques. Chaque méthode a ses propres défis techniques. La décohérence, par exemple, menace la stabilité des calculs et exige des mécanismes de correction complexes.
Voici une comparaison simple entre ordinateur classique et quantique :
- Un bit : 0 ou 1, jamais les deux
- Un qubit : 0, 1 ou superposition des deux états
Dans ces machines, les portes quantiques remplacent les portes logiques conventionnelles. Elles manipulent les qubits, créent des interférences, exploitent l’intrication et s’appuient sur les nombres complexes pour réaliser des calculs impossibles autrement. Le calcul quantique ne se contente pas de tout accélérer : il rebat les cartes sur le plan même de la notion d’information.
À chaque étape, la frontière entre science-fiction et réalité scientifique recule. Demain, l’ordinateur quantique pourrait bien redéfinir nos certitudes sur ce qu’une machine peut, ou ne peut pas, calculer.